Article
Anne-Marie Cauletin-Gillier et Aurélie Boschi
Le concept de « Dyssynchronie »
Jean-Charles Terrassier s’est inspiré du concept d’« hétérochronie » utilisé par Zazzo et son équipe (1960) pour désigner le fait que, comparé à un enfant normal, l’enfant présentant un retard mental se développe « à des vitesses différentes suivant les différents secteurs du développement psychobiologique ». Afin d’éviter toute confusion avec les enfants souffrant de déficience mais aussi de sortir du domaine de la psychopathologie associé au terme « dysharmonie développementale », il lui fallait trouver une dénomination plus en adéquation avec le développement de certains enfants à haut potentiel. La dyssynchronie est, selon lui, l’ensemble des décalages tant internes que sociaux qui peuvent être présents chez un enfant à haut potentiel intellectuel, sans être pour autant systématique. Il a présenté pour la première fois cette notion au 2nd Congrès Mondial pour les enfants surdoués à San Francisco en 1977 où elle a reçu un accueil favorable. Elle a plus tard été vulgarisé en entrant notamment dans le dictionnaire Petit Larousse.
Plusieurs types de dyssynchronies
Parmi les dyssychronies internes
- Une dyssynchronie entre développement des fonctions verbales et développement psychomoteur caractérisée par le décalage entre l’excellent niveau verbal et la moindre aisance motrice, notamment au niveau du graphisme. Ce décalage est souvent mal vécu par l’enfant qui ne peut se satisfaire d’un mode d’expression incapable de suivre le rythme de sa pensée. Jean-Charles Terrassier observait s’ensuivre des conduites d’évitement ou de refus, ne faisant qu’accroitre ce décalage par sous-investissement de certains apprentissages comme l’écriture.
- Une dyssynchronie entre les divers domaines du développement intellectuel caractérisée par des différences significatives entre les indices des échelles d’intelligence de Wechsler. A la lumière de l’avancée de la neuropsychologie, on peut désormais, grâce à un bilan neuropsychologique complet, rechercher d’éventuels trouves des apprentissages ou du développement associés (dyslexies, dyspraxies, troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité), susceptibles d’être plus ou moins bien compensés par les stratégies mise en œuvre et d’engendrer une sous-réalisation du potentiel.
- Une dyssynchronie entre développement intellectuel et socio-émotionnel caractérise par un développement affectif plus en rapport avec l’âge réel, se manifestant principalement par une anxiété et des peurs ne pouvant être maitrisées par un raisonnement intellectuel, aussi brillant soit-il.


Conclusion
Jean-Charles Terrassier concluait que l’enfant HPI subit diverses pressions à la fois dans son environnement scolaire, familial, mais aussi avec ses pairs de même âge, le poussant à avoir un comportement normalisé et l’obligeant en quelque sorte à renoncer à lui-même.
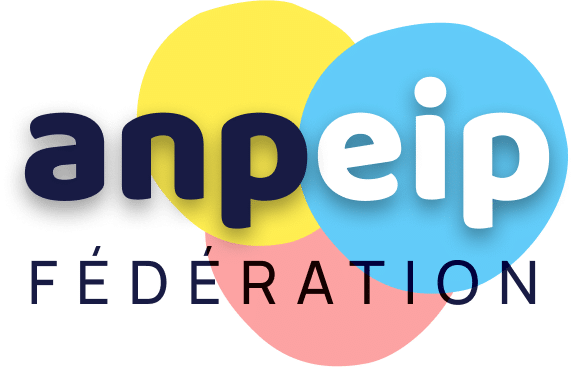
Parmi les dyssynchronies sociales